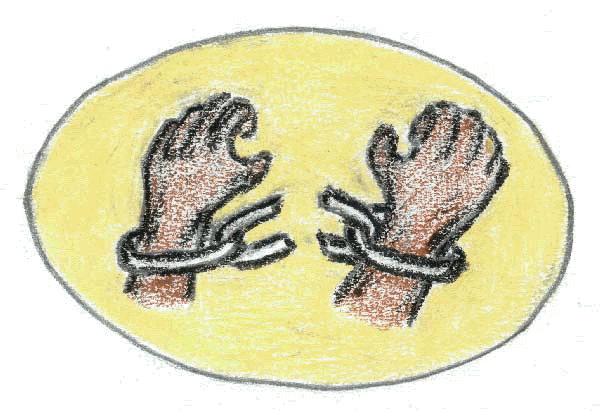Mémoires
d'un enseignant 20
Jeudi 3 juin 2010
L’école de Mansour comptait trois classes, pour un effectif d’à peine vingt d’élèves. Les projets d’éducation étaient passés par là. Cependant et malgré dix ans d’existence, l’école ne comptait toujours pas de collégiens. Dans la zone comme souvent dans la région, l’école était moins une opportunité d’apprendre à lire qu’à calculer, avant de partir, en Côte d’Ivoire, faire le «souvent debout» (c’est ainsi que feu Habib appelait el wegaf), dans une boutique du plateau, d’Ajamé ou de Yopogoun. Comme Agoueinitt, Mansour était un «bon poste de travail», selon la logique des instituteurs. Des parents d’élèves coopératifs. L’garay , entièrement pris en charge, nourri blanchi, assisté. Le village un peu reclus, ce qui permettait des escapades de dizaines de jours, pour entreprendre le «dixième labeur» (El Hem El Acher), loin des regards inquisiteurs d’un quelconque contrôle de routine. J’étais tout, à la fois, comme c’est souvent le cas des enseignants de brousse: directeur, maître des trois divisions pédagogiques, gestionnaire de la cantine, planton, gardien et surveillant de l’école.
C’était pratiquement la même chose que dans tous les autres villages, à quelques exceptions près. La perception de l’enseignant, presque la même chez tous les villageois. Pour eux, c’était un être ordinaire, que les aléas de la vie avaient, au hasard, balancé dans leur village. A cause des comportements de beaucoup d’instituteurs, la mission de l’enseignant était, souvent, négativement perçue. En présence de n’importe quel autre fonctionnaire, gendarme, vaccinateur d’élevage, infirmier, garde forestier, agent municipal, l’instituteur perdait, aussitôt, tous ses privilèges. Parfois appelé, même, à participer à la servitude de ces étrangers «officiels». Le mois d’octobre à Mansour, c’était la période des champs. Souvent le soir, après la classe, je partais rejoindre mes amis, Ehelna et Mohamed, à quelques deux kilomètres au sud du village. Sous un grand arbre, un thé improvisé sur de grosses braises, assorti de quelques graines d’arachides et d’une poignée de biscuits Sarakollé, nous permettait de dégager le complexe ( ?) et d’attendre, tranquillement, que les troupeaux de chèvres finissent, enfin, de brouter quelques dernières herbes, avant la tombée de la nuit. L’occasion, pour Ehelna, de nous raconter, pour la énième fois, les péripéties de son séjour de six mois en Libye, comme domestique dans la maison de l’ambassadeur de la Mauritanie, un parent des Oulad Daoud, comme lui. A l’époque, à cause de l’instabilité sociale au Mali, la zone de Fassala Néré et de Bassiknou était infestée de campements touaregs. Nara était juste à quelque cinquante kilomètres. Régulièrement, les accrochages entre Maliens arabes et bambaras faisaient des morts et blessés. Entre Mansour et Fassala, les chameliers touaregs quadrillaient le terrain. Les marchés hebdomadaires florissaient. C’était de véritables kermesses où les commerçants, venus des quatre coins de la région et parfois, même, d’au-delà – Katawane, Legneiba, Mouacheich, Trenguenbou, Touil, et autres Mavnadech, Adel bagrou, Amourj et Timbedra – proposaient tout. Du beurre de vache, de chèvre, de la viande sèche de chameau, de gazelle, des nattes, des tissus de toutes les couleurs et de toutes les provenances, des graines, des volailles, des animaux et des marchandises de toutes sortes. Les transactions se faisaient et se défaisaient au gré des humeurs, des connaissances et des profits. L’argent, l’ouguiya, le franc, le troc, tout passait, selon des réglementations transfrontalières improvisées dont les sources puisaient leurs origines dans les références, alambiquées, des contractants. Je faisais toujours «rentrer le marché», une expression locale consacrée pour dire «prendre part au marché hebdomadaire». Je n’oublierai jamais que c’est dans un tel marché hebdomadaire que je me suis procuré, à 350 ouguiyas, un livre de grammaire arabe que je détiens encore. C’était, aussi, une bonne occasion, pour les instituteurs de brousse, de liquider, sans risque, les reliquats des produits de leur cantine. Naturellement, je ne connaissais personne, à Fassala, mais j’y venais régulièrement, pour rompre la monotonie du village. Exceptionnellement, les dix instituteurs de sa grande école vivaient seuls et indépendants, dans trois chambres qui les contenaient à peine. Pêle-mêle, cahiers de préparation et de devoirs, vieux livres, chemises sales, pantalons et boubous sans couleur tapissaient la salle, des haillons accrochés sur tous les murs. Ustensiles divers, reliefs d’un thé de la veille côtoyaient matelas, coussins décousus, bouts de pain et «chambres» de tabac, jaunies par les temps. Quand, en fin de semaine, les instituteurs de brousse venaient grossir l’assemblée, l’ambiance devenait vite délétère. Le weekend, rien de spécial. Quelques pains de bois, comme d’habitude, un thé ordinaire, un pot de Gloria, pour le zrig des «autres gens», et un riz, tout blanc, piqueté d’un quart de kilogramme de viande. Habituellement, la journée se passait sans histoires. A l’époque, il n y avait pas encore de téléphone et les instituteurs parlaient de tout: des dernières nouvelles, des vacances, des probables visites des inspecteurs, des prochaines tranches de la cantine, en attendant de retourner dans la paix et le bonheur des leurs.
Mémoires
d'un enseignant 19
samedi 29 mai 2010
J'ai exercé juste
quelques mois dans le village d'Agoueinitt. Mais, malgré cela, je
connus pratiquement tout le monde. Contrairement à mes autres
collègues, je profitais de mes heures de repos pour me pavaner de
maison en maison. Un thé par ci, un zrig par là. Parfois, même,
je surprenais l'unique boucher du hameau en pleine grillade. Vous
imaginez la régalade, alors! Un thé chez Magassa, un vieil
infirmier retraité d'origine malienne, installé, à Agoueinitt,
depuis cinquante ans, n'était jamais de trop. Pendant des heures,
celui-ci me racontait, dans un Hassaniya approximatif, piqueté, çà
et là, de mots français, les épisodes de sa longue carrière
d'infirmier de brousse. Ancien planton d'un colon toubib, le vieux
Magassa soulageait, grâce à une expérience de plusieurs
décennies, les villageois et leur épargnait, ainsi, l'éprouvant
voyage vers les rares centres de santé de la région, sauf pour
les cas extrêmes. Malgré son âge, 60 ans largement dépassés,
il continuait à traîner, inlassablement, son cartable où
médicaments de toutes sortes et de toutes provenances côtoyaient
vieille blouse, trousse, stéthoscope et effet de tabac.
Au
mois de mai de l'année scolaire 91/92, je rentrai à Nouakchott,
après m'être assuré que je n'étais, ni de loin ni de près,
concerné par les modalités du concours d'entrée en sixième.
Tumultueuses vacances car, au bout de quatre mois, mes continues et
diverses manœuvres pour être affecté du Hodh Chargui s'avérèrent
infructueuses. L'année suivante, j'ai été affecté, sur ma
demande, dans la moughataa de Bassiknou, chez les Oulad Daoud.
L'école où je devais servir était située à quelques kilomètres
(19 exactement) de Fassala Néré, soit à peine à plus d'une
vingtaine de kilomètres du Mali. C'était l'école fondamentale
d'edebaye Mansour. Un gros village en banco dont le chef, El
Mahjoub, était un homme encore imposant, malgré son âge, assez
avancé. Sa femme, Fatimetou Zahra, une véritable "grande
royale", entretenait un embonpoint somptueux qui en disait
long sur le faste du milieu où elle avait grandi. Leur unique
fils, Mohamed, dit Ehelna, possédait, à vingt ans, force vaches,
chameaux et troupeaux de chèvres. Mansour était un des rares
riches adwabas de Mauritanie et, sûrement, le village le plus
nanti de la zone. Les autres localités de Kleiva, Khairelgani,
Terbekou et autre Kossana gravitaient autour de lui. J'y ai
débarqué, la première fois, d'une Land Rover 110 appartenant à
un projet d'élevage qui intervenait dans la zone et dont le
coordinateur, l'ingénieur El Joud Ould Salek, était un ami. Nous
arrivâmes aux environs de 19 heures. Juste au moment où les
troupeaux revenaient du pâturage. L'ambiance était
indescriptible. Meuglements d'enfer, poussière suffocante, à la
lueur enfumée des feux incandescents des ménages. Aux abords de
la tente dressée devant la maison du chef de village, Fatimetou
Zahra, drapée dans une belle melehfa, finissait ses prières du
crépuscule. Après avoir égrené son chapelet, elle nous salua
chaleureusement et, avec une autorité remarquable de naturel,
ordonna à une jeune femme de commencer les rituels de l'étranger.
Aussitôt, des calebasses de lait frais et des verres de thé nous
furent servis. A quelques mètres de nous, au coin de la zériba
des agneaux, un homme s'affairait à dépecer un mouton. Nous
étions, maintenant, bien à l'aise. L'odeur de la viande grillée
embaumait l'air, attirant, des quatre coins du village, hommes et
femmes venus, prétendument, saluer, "à chaud", les
visiteurs. Il faut dire que "refroidir le salut" de
l'étranger est fortement déconseillé, dans la tradition maure.
Vinrent les présentations. Mon ami El Joud était très connu dans
la zone et c'était de moi, surtout, qu'il s'agissait. Mon statut
de maître d'école ne suffisait pas. Je devais répondre aux
traditionnelles questions. Desquels de nos frères es-tu? Allusion
à ma tribu. Wakhyertt. Un compliment qui ne veut rien dire,
puisque, de toute façon, c'est la réplique standard à la moindre
présentation. De quelle région? Et comme, en Mauritanie, la vie
privée fait partie de la vie tout court, ma situation familiale,
le nom de ma femme, le nombre de mes enfants m'ont été demandés,
naturellement, simplement, naïvement. La veillée de la première
nuit dura jusqu'aux environs de 23 heures. Sans aucun protocole,
chacun s'endormit à la place où le sommeil le prit, dans un vaste
espace dégagé, caressé par la brise froide d'un mois d'octobre
finissant…
La suite en cliquant
sur les liens suivantes :